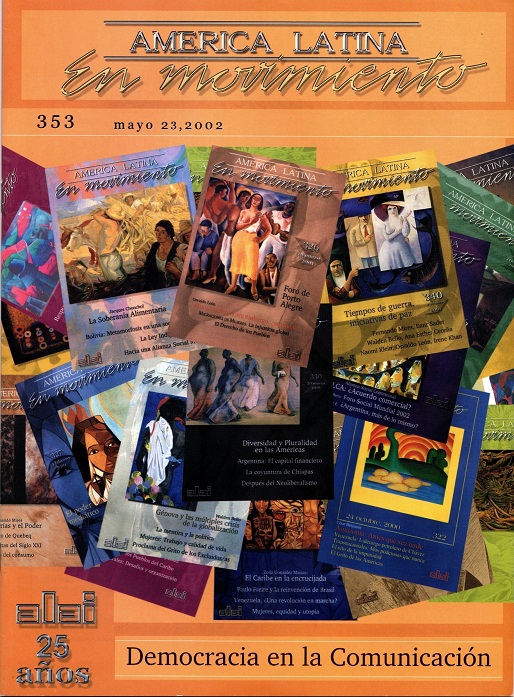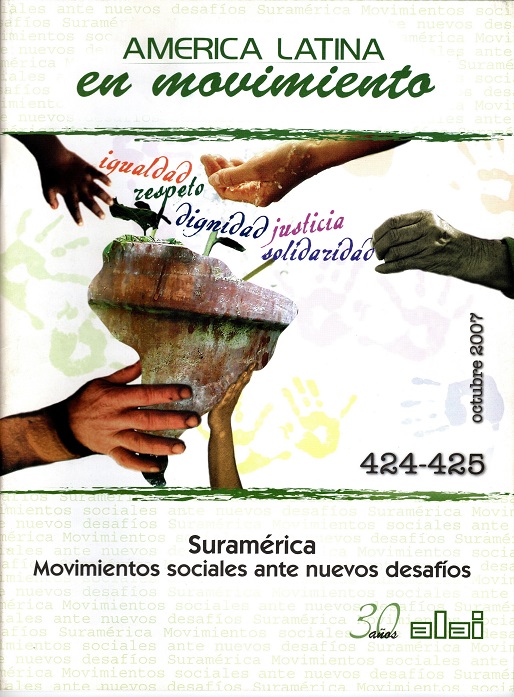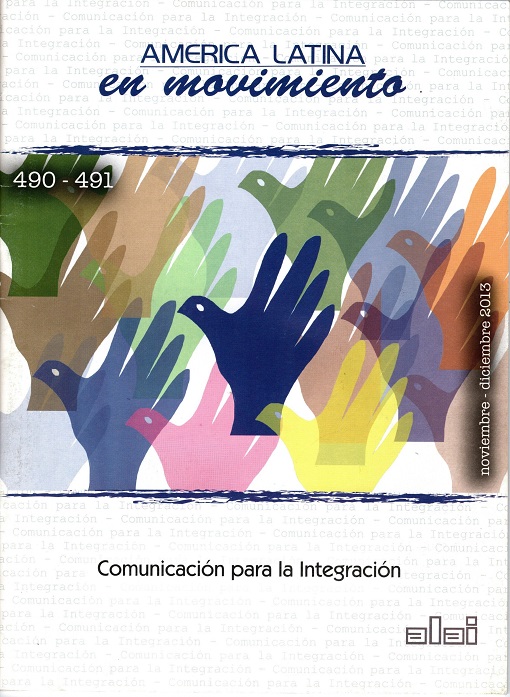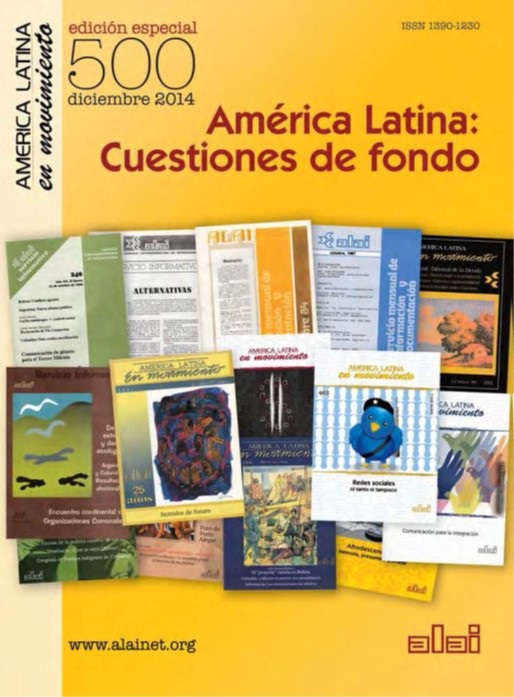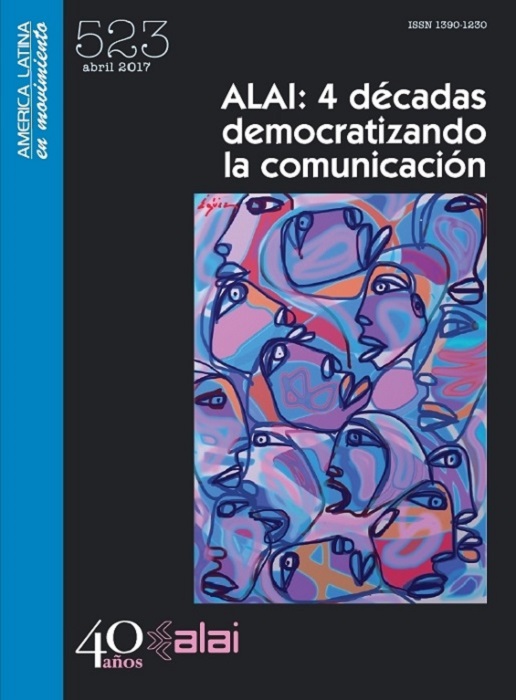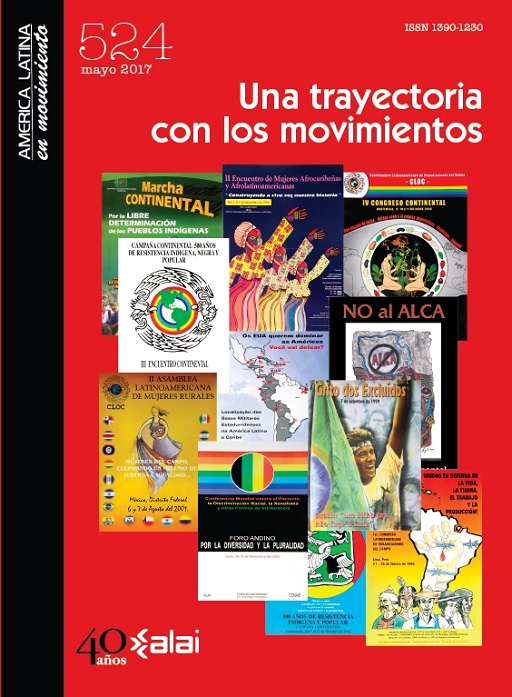“La globalisation actuelle exige un nouveau paradigme de coopération”
- Opinión
Si la globalisation est la logique prédominante sur la planète; si la terre est un espace commun unique et les êtres humains une espèce profondément interdépendante, alors la vieille notion de coopération Nord-Sud doit être redéfinie. “C’est le moment de trouver un nouveau paradigme, qui dépasse l’ancien et dynamise le nouveau, qui soit un axe essentiel des relations planétaires” souligne Leonardo Boff, théologien de la libération, l’un des plus importants penseurs latino-américains contemporains, et partenaire historique de E-CHANGER. Dans cet entretient exclusif, Boff propose le pari d’un “Contrat social universel”, qui serait régit par des relations justes et une culture du dialogue et du consensus, et, en particulier, par une coopération réellement solidaire.
Q: L’humanité vit sur une planète toujours plus globale. Quel est le défi présent et futur des relations entre les hémisphères, les continents et les êtres humains?
R: Cette globalisation marque une nouvelle étape de l’histoire de l’humanité et de la terre, qui se caractérise par le fait que tous les peuples, les cultures, les traditions, les religions, se trouvent en un lieu unique, la maison commune, la planète terre. En conséquence, nous devons partager, il n’y a pas d’autres alternatives. Ce concept constitue peut-être l’aspect particulier du moment. Peut-être aujourd’hui plus que jamais, l’être humain se découvre comme une espèce, comme une famille qui habite un espace qui comporte des ressources limitées, en surpopulation sur une planète malade à cause du réchauffement global et du déséquilibre prononcé des écosystèmes.
Cette constatation globale exige une solution globale. Or, une action globale ne peut résulter que de la collaboration et de la solidarité que chaque culture, chaque religion, chaque être humain, chaque église, chaque pays, peut apporter afin que cela bénéficie à l’ensemble. En cela, la globalisation actuelle exige une nouvelle coopération et une nouvelle solidarité.
La coopération régit l’univers
Q. C’est-à-dire?
R. Sans la coopération et la solidarité, nous resterions prisonniers du vieux paradigme qui se caractérise par la compétition et non par la collaboration. Cela signifie un monde de conflits, d’affrontements, d’une grande accumulation pour une partie minuscule au détriment de l’autre partie majoritaire, qui se retrouve exclue.
Je pense que, pour la première fois, étant donné l’importance de la crise, se donne la possibilité que les ressources de la terre puissent être distribuées de façon équitable pour tous les être humains. Cela exige une gestion globale et consciente des ressources dont nous disposons. Et de là naissent les catégories centrales que sont la coopération et la solidarité. Ces concepts ne dépendent pas de la vertu personnelle que chacun peut avoir ou pas, mais d’une coopération et d’une solidarité dans un cadre général, confirmé par les astrophysiciens, les biologistes et les scientifiques en général. Ces derniers affirment que la loi la plus universelle de l’univers est la coopération de tous avec tous. Comme disait Heisenberg [un physicien allemand], la loi suprême est que tout est lié, à tout moment et en toutes circonstances. Tout est interconnecté. Le tout est constitué de la somme des entités virtuelles et réelles, par l’ensemble des énergies de tous les êtres. Et c’est là que régissent la coopération et la solidarité des uns avec les autres, afin que tous puissent vivre et coexister en assurant le respect de la biodiversité.
Q. Soutenez-vous l’image de la planète comme une maison commune, et des êtres humains – sur quelque continent qu’ils se trouvent – comme une grande famille humaine?
R. La notion d’Etat-Nation existe et il a sa fonction, mais d’une certaine façon il s’agit d’une catégorie du passé. Maintenant, l’unique Nation est la terre. Et tous les êtres humains en sont citoyens. Il s’agit de conserver les expériences que tous ont fait au cours des siècles, dans leurs cultures, leurs écosystèmes, leurs systèmes de valeurs et de spiritualité propres, car tous apportent quelque chose et tous sentent que ces dimensions sont toutes humaines. Cela signifie que l’être humain peut être humain de mille façons différentes. Il n’existe pas une seule manière d’être, qui serait occidentale et chrétienne. Toutes ces manifestations diverses sont dignes de respect, expriment la richesse de ce que signifie l’être humain. C’est là qu’apparaît la famille humaine, avec ses différents visages, tous et toutes frères et sœurs, avec des manières de vivre différentes, mais tous membres de la même et unique famille.
Il y a beaucoup d’espèces d’êtres vivants. Parmi elles, l’être humain, qui forme cette famille dont j’ai parlé. Et le grand rêve de toute famille, aussi petite soit-elle, est de se réunir, de se réjouir ensemble, de fêter la générosité de la nature. Et c’est également le rêve de la famille humaine que de s’asseoir autour de la table commune, afin de jouir de ce que la terre peut nous offrir, ainsi que des biens culturels que nous avons créés. Et alors, dans ce cas, la famille se sentira heureuse. Non pas dans une vallée de larmes, mais dans un lieu de béatitudes.
L’ancien paradigme de la coopération
Q. La réalité de la coopération, aujourd’hui, diffère de votre vision humaniste et humaine, avec la reproduction des mécanismes d’exploitation du Sud par le Nord… Et parfois, dans ce cadre-là, on peut considérer que la coopération fonctionne comme un mécanisme permettant de tranquilliser les consciences.
C’est là la stratégie du vieux paradigme. Que certaines nations soient hégémoniques, que l’une soit un empire, domine tout et impose la voie à suivre. Ce paradigme ne cherche pas à changer le système, mais, au mieux, à diminuer ses effets négatifs. Et c’est ici qu’entre en jeu la vision traditionnelle de la coopération, qui ne change ni les relations de pouvoir ni les privilèges. La terre crucifiée, divisée en de nombreux pays, exploitée. Avec une coopération qui existe, mais qui ne constitue pas l’axe même de la société planétaire, qui ne sert qu’à tranquilliser la mauvaise conscience de certains et à tenter de calmer ceux qui souffrent afin qu’ils ne se rebellent pas, pendant que le système qui crée des marginaux se maintient intact. Je pense que cette vision est usée, dépréciée. Ou nous changeons totalement de direction et de références, ou nous allons vers un conflit généralisé.
Globalisation, balkanisation et coopération
Q. Dans ce défi des paradigmes apparaît un concept – très débattu dans les divers Forums Sociaux Mondiaux - d’un poids particulier: celui du Sud Global. Quel est votre vision à ce propos?
R. Il y a deux attitudes et tâches importantes. La première est celle de renforcer les pays du Sud afin qu’ils aient plus de force dans leurs négociations avec le Nord. En revendiquant, par exemple, de meilleurs prix pour leurs produits dans le commerce international et en influençant les politiques internationales.
La deuxième consiste à se rendre compte que le processus mondial est contradictoire: il existe en même temps une globalisation et une balkanisation.
En ce sens, il est très important qu’il existe cette articulation du Sud Global, parce que c’est là que se trouvent les ressources dont a besoin le Nord: l’eau douce, le pétrole, la biodiversité. Tout cela se trouve au Sud, mais est toujours plus recolonisé par les entreprises multinationales.
S’il existe effectivement cette contradiction entre le Nord et le Sud, il est important de voir la terre de la façon dont la voient les astronautes, comme une entité unique, et avec elle l’humanité formant un tout unique. De là-haut, on ne voit pas les différences entre le Nord et le Sud, ni entre catholique ou musulman, etc.
Dans le nouveau paradigme, cette façon de voir est fondamentale. Il s’agit d’empêcher ce que l’actuelle exploitation des ressources essaye de faire: diviser la grande famille humaine. Le grand risque aujourd’hui est que les puissants construisent un Mur de Berlin qui sépare le Nord du Sud. Qu’ils utilisent toutes les nouvelles technologies et les avancées de la science, comme la biotechnologie ou les nanotechnologies, afin que dans le Nord on vive jusqu’à 130 ans, tout en laissant le reste de l’humanité en dehors.
Et je pense que l’un des défis humanistes clés aujourd’hui – qui incombe également aux églises – est celui de maintenir la famille humaine, d’empêcher sa partition.
Et là, je reviens avec insistance sur la valeur du nouveau concept de coopération. Il ne s’agit pas de la penser comme une donnée de plus, mais bien comme un projet personnel et collectif, qui encourage les relations entre les peuples et maintienne unie la famille humaine. Dans le cas contraire, il y aura de profondes déchirures.
Q. Il s’agirait donc de comprendre le Sud Global comme l’union des marginalisés, autant au Nord qu’au Sud…
R. Cette remarque est très importante. Il ne s’agit pas de comprendre ces notions de Nord et de Sud comme des catégories uniquement géographiques, mais également sociologiques. Et l’union de ce Sud global est essentielle, parce que cela donne de la force au cri contre l’injustice. Il faut définir une espèce de diplomatie populaire. Que les peuples se rendent visite, se rencontrent, se « sentent », prennent conscience de leur respective volonté d’aimer, de construire…. Et alors les préjugés disparaissent rapidement. Nous nous apercevons alors que nous sommes tous humains, fragiles, remplis de désirs, que nous recherchons tous le bonheur. Que tout cela vaut beaucoup plus qu’un compte en banque bien garni, que l’être humain est beaucoup plus important que n’importe quel projet technologique. Mais tout cela n’est possible, j’insiste, qu’à partir du contact peau à peau. Pourquoi ne pas promouvoir un véritable Contrat Mondial Social, qui aujourd’hui n’existe pas. Un Contrat qui naisse d’en bas, des peuples.
Une nouvelle cosmovision
Q: Pourriez-vous définir de façon plus précise ce nouveau paradigme de société planétaire? Certains concepts-clé de cette dernière?
R: Plus que des préceptes ou des règles, il me semble qu’il nous faut penser en termes de direction, de cap. Premièrement, la conviction que nous n’avons qu’une terre comme maison humaine. Ensuite, que la terre-humanité est une grande unité. La terre ne porte pas seulement la vie, elle est vie elle-même. Cette terre-humanité doit être protégée, parce qu’elle est menacée par les activités irresponsables des êtres humains, en particulier depuis trois cents ans, avec la généralisation du mode de production industriel.
Troisièmement, l’éthique fondamentale est celle du soin. Tout ce qui vit exige des soins. Nous-mêmes nous n’existerions pas sans les soins que nos mères nous ont prodigués à la naissance.
Un autre point important est que nous devons développer la compassion. Pas sous la forme d’une piété, mais en promouvant la capacité de ressentir comme l’autre. Et créer des structures qui permettent que la terre puisse exister.
Le cinquième aspect est celui de la responsabilité universelle. Nous devons nous rendre compte des conséquences de nos actes. Nous ne pouvons générer une guerre aujourd’hui, parce que cela signifierait la destruction de l’espèce humaine. Nous ne pouvons pas utiliser les organismes génétiquement modifiés, parce qu’ils ont des conséquences énormes sur la structure de la vie. Cela implique de promouvoir une éthique de la vie, d’avoir dans chaque pays ou région des conseils d’éthique qui étudient les conséquences des actes. Promouvoir une science avec conscience; non pas une science pour le développement, mais une science pour la vie, qui bénéficie aux grandes majorités.
De façon complémentaire, je suis convaincu qu’une éthique ne s’impose pas s’il n’existe pas une certaine aura de spiritualité, un sentiment plus ample de la vie. Nous sommes accrochés à quelque chose qui transcende le monde, qui le maintient et qui permet à la vie de continuer. Quelque chose qui met de l’ordre dans le chaos de l’univers et que les êtres humains respectent et apprécient. Les religions ont appelé cela Dieu. En tout cas, sans cette spiritualité, l’être humain ressent un vide énorme.
Et un avertissement: il est bien que les cultures développent tout cela. Il ne faut pas laisser le monopole de la spiritualité aux religions, mais en faire une donnée anthropologique.
La coopération « peau a peau »
Q. Revenons à la coopération. Vous avez parlé précédemment de l’importance du contact « peau à peau » pour la construction d’une nouvelle culture planétaire. Il y a une tendance au Nord à sous-estimer la coopération qui promeut l’échange entre personnes, par rapport au transfert de technologies et aux résultats quantitatifs et mesurables.
R. Cette critique provient du vieux modèle d’un développement uniquement matériel, qui recherche avant tout l’efficacité, qui voit les relations objectives avec la nature comme plus importantes que les transformations sociales. C’est là une vision faible, parce qu’en vérité, le garant du bonheur des êtres humains, ce qui unifie la famille humaine, ce n’est pas le cumul des biens matériels ou une technologie plus développée, mais le sentiment de bonheur, l’auto estime, la reconnaissance, le respect, l’amour entre les personnes et les peuples. Ce garant n’est pas déposé à la banque ni à la bourse, mais dans le cœur des êtres humains.
La lutte entre ces deux paradigmes touche également la coopération. L’ancien est matérialiste, calculateur, obnubilé par l’efficacité.
En réalité, nous avons besoin de la technologie, de la science, de la production. Nous ne sommes pas obtus dans notre façon de penser. Mais nous voulons un modèle dans lequel la science puisse intégrer la poésie, dans lequel la production s’intègre à la célébration et à la fête, une combinaison complexe qui fasse la plénitude de l’être humain.
Q. Une autre tendance de la coopération est de ne pas parvenir à transcender la relation macro Nord-Sud. Elle ne comprend pas qu’il existe un véritable potentiel dans l’échange Sud-Sud et qu’il existe de nouveaux espaces, comme celui des réseaux mondiaux, celui des forums sociaux, qui favorisent significativement une future forme de coopération différente…
R. Pour cette tendance de la coopération, il est contradictoire d’accepter notre cosmovision, parce qu’elle est anti-systémique. Et ces catégories tellement importantes comme l’échange, l’enrichissement interculturel et mutuel, etc., ne rentrent pas dans l’univers mental de ceux qui défendent les nombres, les comptes, la rentabilité.
Il est essentiel de construire une plateforme commune, humaine, basée sur le dialogue. Ce qui peut faciliter le dialogue entre le gérant d’une transnationale suisse et une personne de la base d’un pays latino-américain, ce n’est pas la rationalité, mais la raison sensible, l’intelligence émotionnelle.
Etant donné que le monde est globalisé, il faut généraliser l’appareil de conversation. Que tout le monde entre en conversation, dans l’échange. Et à partir de cette base, accentuer les points communs, les convergences dans la diversité.
La conception qui ne donne pas la priorité à cet échange interpersonnel finit souvent par miser sur la violence comme vecteur d’imposition, qu’elle soit militaire, idéologique, informative, etc.
Q. Une réflexion finale…
R. Partager avec vous une conviction qui, je crois, est mutuelle. Dans mon cas, après tant d’années de luttes – dont beaucoup ont été perdues, parce que le système nous a vaincu plus d’une fois – je retiens deux éléments importants. L’un, que malgré tout, nous avons continué, nous avons persévéré, sans concessions. L’autre, que nous nous considérons comme des graines. Et cela est très important. Afin que, ensemble avec d’autres, nous les transformions en grands arbres…
- Entrevue à l'occasion du 50ème anniversaire de E-CHANGER, ONG suisse de coopération solidaire
Source: Service de presse E-CHANGER
(Traduction Mathieu Glayre)
Del mismo autor
- Las balas no matan al COVID y sus variantes 05/04/2022
- Le journalisme en crise 21/03/2022
- El periodismo en crisis 21/03/2022
- L’Amérique latine et les objectifs de développement 16/03/2022
- Latinoamérica y los objetivos 2030 de la ONU 14/03/2022
- Effets collatéraux 03/03/2022
- Efectos colaterales 03/03/2022
- Le Brésil dans la ligne de mire de l'ONU 15/02/2022
- Brasil en la mira de la ONU 15/02/2022
- Bancos suizos, todo menos santos 09/02/2022